12
oct.
2008
Chaque année depuis 1901, l'Académie suédoise des sciences récompense du prix Nobel une poignée de découvertes ou d'inventions qui ont particulièrement mérité. Ces découvertes font souvent l'objet d'un consensus. Mais le paradoxe est que le prix est remis aux auteurs de ces découverte, les propulsant ainsi au rang de "génies", consultés à propos de tout — des problèmes sociaux à la stratégie militaire[1] —, invités à signer toutes sortes de pétitions et à siéger au sein de fondations fantômes… à moins qu'ils ne soient ostracisés pour faute grave comme James Watson !
J'ai pu constater de visu lors du ''World Knowledge Dialogue Symposium'' que les prix Nobel sont certes des experts dans leur domaine mais que ça n'en fait pas forcément des surhommes, ou même des lumières. Tom Roud signalait d'ailleurs combien Albert Fert, invité sur France inter, semble éloigné de la réalité de la recherche (c'est-à -dire de la situation des doctorants et post-doctorants). D'où ma question : à quoi sert un prix Nobel ? Pourquoi, au-delà du prestige et de la renommée, peut-on en avoir besoin ?
Pour y répondre, je vais m'intéresser à ce que la sociologie des sciences dit de l'expertise, en particulier Harry Collins dont Phnk signalait récemment les travaux et le livre qu'il a publié en 2007 avec Robert Evans, Rethinking Expertise. En effet, c'est acquis que les prix Nobel sont des experts de leur mini-champ de compétence : Albert Fert de la magnetorésistance géante, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi du VIH… Nous sommes en présence, pour reprendre la typologie de Collins et Evans, de l'expertise contributrice (contributory expertise) : celle qui permet de participer à l'avancement d'un domaine, et de transmettre son savoir à des étudiants ou collègues. C'est cette expertise qui justifie en premier lieu la remise du prix Nobel.
Mais ce n'est pas tout. Un prix Nobel a pu s'illustrer par son approche nouvelle d'un problème, par sa compréhension inédite des limites d'un domaine. Ainsi, Pierre-Gilles de Gennes avait son propre style de scientifique, un style qui le distinguait de ses pairs et qui constitua un apport de niveau "méta" à la physique. Cet apport peut très bien faire école et inspirer d'autres percées, à condition de posséder cette disposition à l'interaction et la réflexivité que décrivent Collins et Evans (p. 27), permettant de se projeter pour pouvoir décrire et expliquer ce qu'on fait. Ce qui n'est pas donné à tous les praticiens ou prix Nobel, comme le montre cette citation attribuée à Richard Feynman : La philosophie des sciences est aussi utile aux scientifiques que l’ornithologie l'est aux oiseaux.
Mais le récipiendaire du prix Nobel, une fois couronné, est aussi invité aux quatre coins de la planète à rencontrer le gratin mondial. Une particularité de ces colloques, comme celui de Lindau, est qu'ils rassemblent au-delà des disciplines et des thèmes de recherche. Ainsi, à force de voyager et de côtoyer des spécialités aussi différentes, le prix Nobel acquiert et mobilise une des "méta-expertises" décrites par Collins et Evans. En particulier, l'expertise projetée (referred expertise, par analogie avec la referred pain) consiste à appliquer à un domaine l'expertise acquise dans un autre. C'est le propre des gestionnaires de gros projets de recherche, comme le radiotéléscope ALMA, qui peuvent être à la tête d'un interféromètre un jour et d'un collisionneur géant le lendemain. Car ce qui importe, ce n'est pas l'expertise qui permet de mettre les mains dans le cambouis (contributory expertise) mais celle qui permet de parler à chacun, d'évaluer différentes options, de faire les choix qui se révéleront finalement les plus pertinents.
Ainsi, les Nobel ont cette chance de pouvoir se consacrer surtout à cette expertise projetée. Profitant de l'autorité qui leur est reconnue, s'enrichissant du contact des uns et des autres, ils peuvent devenir l'huile qui va faire mieux tourner les rouages de la science. Pour autant, c'est bien toujours d'expertise que nous parlons ici : contrairement à une idée souvent répandue, cela n'en fait pas des esprits plus sages, plus moraux ou plus respectueux…
Notes
[1] Depuis au moins les années 1940, nous signale Robert M. Friedman dans la numéro d'octobre de La Recherche, p. 29.



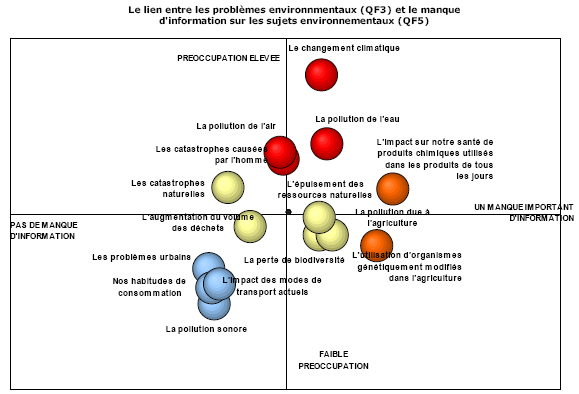
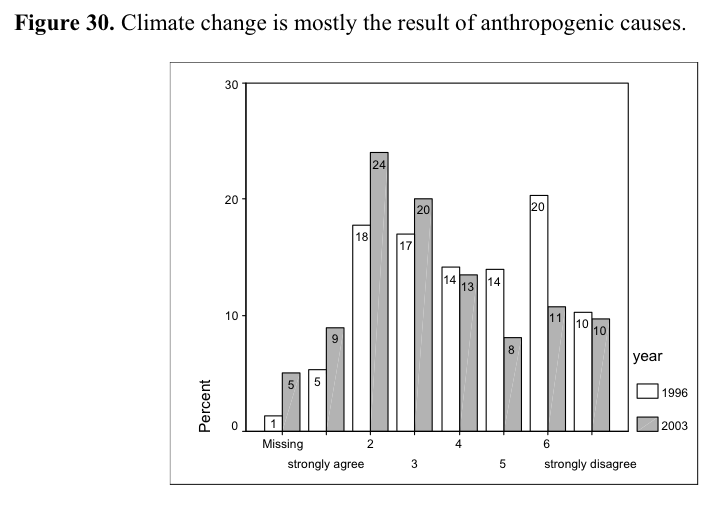

Derniers commentaires